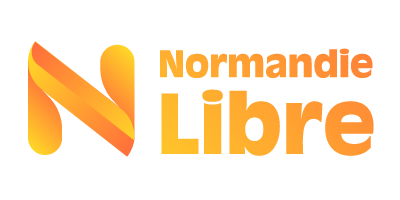Qu’on le veuille ou non, la jupe n’a jamais été un simple morceau de tissu. Derrière ce vêtement, c’est toute une histoire de rapports de force, d’émancipation et de métamorphoses sociales qui se trame, bien loin du cliché rétro. À l’heure où les dressings débordent de jeans et de pantalons fluides, une question se faufile dans les plis : comment la jupe, autrefois incontournable, s’est-elle retrouvée reléguée au rang d’option parmi d’autres ?
La jupe à travers les âges : un vêtement universel aux multiples visages
Ce serait sous-estimer la jupe de la croire réservée aux femmes et à la mode d’un autre temps. L’histoire montre tout autre chose. Dans l’Antiquité, nul ne s’embarrassait du genre : tout le monde, ou presque, adoptait tuniques et pagnes. À Rome, citoyens et citoyennes partageaient le goût des étoffes amples, sans même évoquer la notion de vêtement féminin ou masculin. Le Moyen Âge prolonge cette diversité ; l’appartenance sociale définit les tenues bien plus sûrement que le genre. Partout en Europe, la robe longue habille autant le puissant que la puissante.
Mais les habits prennent un autre tour au xviiie siècle. L’ordre social se raffermit, le pantalon s’impose du côté masculin, la jupe se concentre sur les femmes. Les tenues d’enfance restent unisexe, mais vers l’adolescence les rôles se séparent nettement. Paris et la France deviennent alors le théâtre de la mode : arborer une jupe, c’est choisir son camp, montrer son appartenance, sa différence ou sa fidélité à la tendance.
Le xixe siècle impose une rigueur nouvelle : crinolines, corsets, tournures imposent leur diktat sur la silhouette féminine. On façonne la jupe, on sculpte les corps pour entrer dans le moule contemporain. Mais les temps bougent. Avec le début du xxe siècle, des créateurs comme Paul Poiret libèrent les femmes de ces carcans, les jupes deviennent souples, réduisent les entraves, flirtent avec l’audace. La minijupe qui surgit plus tard, portée par Mary Quant, va faire basculer tous les codes.
La jupe n’a jamais cessé d’évoluer, entre unité et excentricité, traditions et transgressions. Soumission pour certains, rébellion pour d’autres, elle concentre tour à tour les tensions sociales et les désirs d’émancipation. Suivre l’histoire de la jupe, c’est lire en filigrane l’évolution des relations femmes-hommes.
Quels facteurs ont conduit à la remise en question de cette tenue emblématique ?
Pendant de longues décennies, la jupe incarnait la norme pour la garde-robe féminine. Mais elle a vu son monopole s’effriter, emportée par les bouleversements du xxe siècle. L’irruption du pantalon dans le vestiaire des femmes n’est pas qu’une tendance de passage : cette adoption massive traduit des changements profonds dans la société. Dès les années 1920, la silhouette se masculinise, mais c’est la Première Guerre mondiale qui accélère la rupture : contraintes par la nécessité, des milliers de femmes adoptent des vêtements pratiques. La jupe cède du terrain. Puis la Seconde Guerre mondiale ancre le pantalon dans la vie courante. Impossible de reculer, l’habitude est prise.
Après 1945, la mode évolue à grande vitesse sous l’impulsion de créateurs comme Jean Patou, André Courrèges ou Yves Saint Laurent. Les années 1960 voient la minijupe arriver sur scène : elle plaît à la jeunesse, marque la coupure avec la génération précédente, mais ajoute aussi à l’ambiguïté. Rapidement, le jean puis le pantalon tailleur détrônent la jupe, qui ne conserve plus qu’une place parmi d’autres options.
Le regard sur le corps féminin se métamorphose. Porter l’espoir d’égalité, comme le martèle Christine Bard, suppose de s’interroger sur la fonction même des vêtements : pourquoi éternellement assigner la jupe aux femmes ? Avec leur entrée dans les universités, dans le monde du travail, dans toutes les sphères publiques, les usages changent. Les magazines comme Vogue valorisent la liberté de style : on préfère le confort, la neutralité, on se libère du code unique. Progressivement, la jupe n’est plus une sanction sociale, mais un vêtement parmi d’autres, soumis au vrai choix.
Pour éclairer ces bascules, citons les leviers principaux de ce changement :
- Évolution des normes sociales : la jupe perd son statut automatique dans le vestiaire féminin.
- Transformation de la mode : le pantalon s’impose comme un étendard d’indépendance.
- Nouvelles aspirations : confort et liberté priment sur les héritages traditionnels.
Entre normes sociales et conquête de liberté : la jupe, témoin de l’émancipation féminine
Longtemps, porter une jupe allait de soi, avant que la pièce elle-même ne devienne le symbole d’un débat sur le genre et l’appartenance. Dès les années 1970, Paris bruisse d’une société qui se réveille : la libération des mœurs, l’émancipation, s’étalent dans la rue comme dans les esprits. Les femmes se libèrent du regard prescripteur, refusent le carcan de la séduction imposée. La jupe ne sert plus de preuve de féminité, elle révèle parfois un choix affirmé, voire une prise de position contestataire.
Les combats menés à la fin du xxe siècle remuent les fondations : des figures comme Christine Bard, des mouvements comme Ni putes ni soumises, font de la mode un territoire de revendication. Il s’agit d’arracher le droit de porter ce que l’on veut, d’en finir avec le vêtement qui enferme ou stigmatise. Pour les filles, la liberté vestimentaire devient un enjeu à part entière : elles veulent s’habiller sans qu’on leur colle une étiquette.
D’aujourd’hui à demain, la modernité s’exprime dans la diversité et la liberté de création. Porter une jupe avec un blazer affirmé, accessoiriser avec un foulard vif : voilà un geste d’expression individuelle, jamais d’allégeance. Ce qui bouge à Paris innerve la France dans son entier, galvanise les banlieues et façonne la société sur le long terme.
Quelques principes forts se détachent de cet élan :
- Émancipation féminine : la jupe participe désormais d’un choix personnel, entre affirmation et autonomie.
- Rapport au corps : le vêtement devient territoire de contrôle et de visibilité, non d’assignation.
- Transgression : composer son style, c’est souvent bouleverser les cadres établis.
Les choix vestimentaires d’aujourd’hui, héritiers d’une longue histoire
Ouvrir la garde-robe d’aujourd’hui ne ressemble en rien à une époque révolue où la jupe dominait sans partage. Désormais, pantalons et jeans s’imposent sur tous les trottoirs de Paris, de Lyon ou de New York. La mode contemporaine se veut inclusive : chaque individu invente sa façon de conjuguer les codes, la jupe n’est plus qu’un accent de style parmi d’autres possibles.
Les créateurs, de ceux qui repensent le genre à ceux qui revisitent les coupes classiques, rédigent une nouvelle partition. Le Musée des arts décoratifs à Paris met en lumière cette mue continue, du XVIIIe siècle à aujourd’hui. Désormais, les coupes s’affranchissent des contraintes, la liberté de mouvement devient un critère-clé, la silhouette s’adapte à la vie réelle.
Regardez autour de vous : les jeunes femmes privilégient le pratique, basket et pantalon droit en tête, tout en se réservant le droit d’opter pour une jupe selon l’envie, l’occasion, ou tout simplement le besoin de se distinguer. Les hommes en pantalon passent inaperçus, tout comme les femmes. La mode se vit à la première personne du pluriel : multiple, composite, inventive, elle accompagne la société sur la voie d’une pluralité assumée.
La jupe n’a pas disparu, loin de là. Elle observe, elle attend son heure, prête à écrire de nouveaux chapitres. Et demain, sans crier gare, elle pourrait bien redevenir le centre de toutes les attentions, emportant nos certitudes sur son passage.